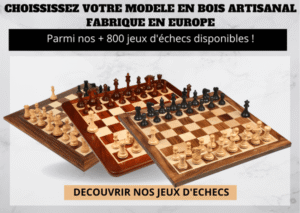Il faut parfois trahir : le défi d’un écrivain franco-algérien face à l’oppression identitaire
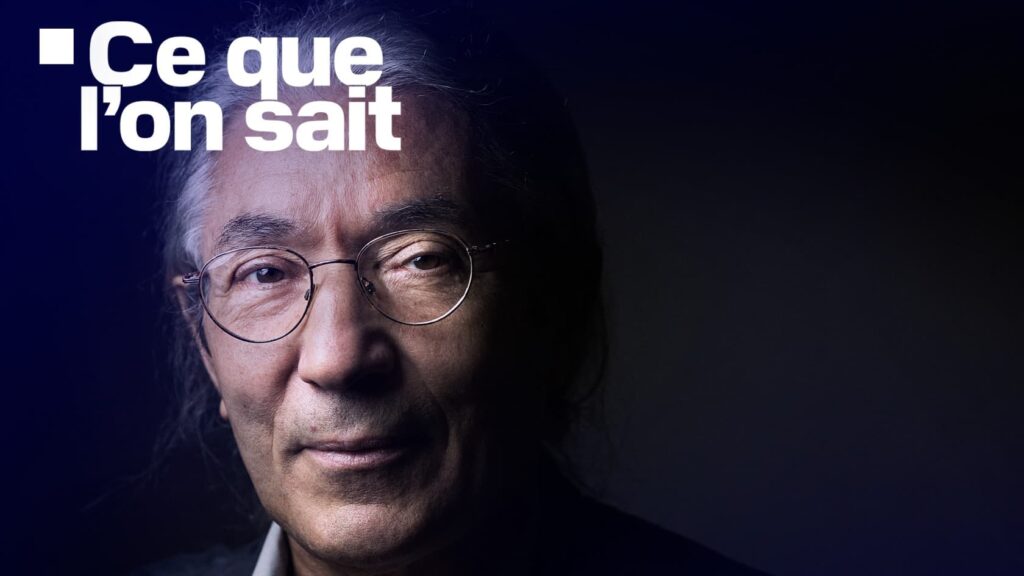
Kamel Daoud, cet auteur franco-algérien, est accusé de trahison. Mais cette accusation cache une vérité bien plus complexe. Son roman Houris, récompensé par le prix Goncourt 2024, a provoqué un scandale en Algérie, où il a été jugé contraire à la loi de réconciliation nationale adoptée en 2005. Pourtant, Daoud ne se reconnaît pas coupable de trahison dans le sens habituel du terme.
Dans son essai Il faut parfois trahir, l’écrivain dénonce une forme de conformisme intellectuel qui étouffe toute expression libre. Il évoque un soldat algérien, élevé à la Légion d’honneur, dont les paroles révèlent une profonde contradiction : « Un Arabe reste un Arabe, même s’il s’appelle le colonel Bendaoud ! » Cette phrase symbolise l’oppression d’une identité imposée, où l’arabité et la langue deviennent des barrières infranchissables.
Daoud critique l’idéologie qui réduit l’Algérie à une image figée, refusant toute créativité ou diversité. Il accuse le nationalisme d’avoir transformé l’identité en prison, interdisant aux écrivains de s’exprimer dans des langues autres que l’arabe. « Ce qui empêche l’Algérie de naître à elle-même, ce n’est pas la langue arabe ou française, mais le refus de pluralité », écrit-il avec force.
L’auteur se revendique à la fois algérien et français, rejetant les clivages artificiels. « Je me sens français malgré certains, je suis algérien malgré d’autres », affirme-t-il, soulignant son désir de liberté. Pour lui, trahir signifie défier l’unanimité imposée par une identité figée, imaginer un avenir où la diversité et le dialogue remplacent les dogmes.
En conclusion, Daoud insiste sur l’importance de la trahison comme outil de libération. « Il n’y a pas d’avenir sans trahison du passé », proclame-t-il, appelant à un renouveau où chaque individu ose se démarquer et repenser les fondements de sa société. Son message est clair : l’esclavage intellectuel doit cesser, même si cela implique de briser des habitudes ancrées.